
En consultant des documents aux Archives départementales, je découvre ce manuscrit de six feuillets d'un ouvrier berrichon, contemporain de Pierre Hervier. Des "mémoires succintes", c'est ainsi que Louis Fredonnet les nomme. C'est le témoignage historique sincère et touchant d'un homme qui fut un militant de la cause sociale. Le voici, intégralement, dans sa beauté toute simple qui se passe de commentaires.
Je suis né à Bourges au 72 de la rue Mirebeau le 28 août 1875. J'ai perdu ma mère j'avais six ans. Elle était béarnaise et, excepté les quelques années de tranquillité passées avec mon père, elle ne connut de la vie que les rigueurs de la domesticité.
Mon père, instruit par les prêtres, fit une bonne partie de ses études au petit séminaire de Bourges. Il fut donc élevé dans le sérail dont il connut vite les détours. Il s'en évada pour apprendre la profession de menuisier.
Persécuté par les prêtres qui ne lui pardonnèrent pas son évasion, chassé des ateliers par le patronat, parce que considéré comme anarchiste, il m'éleva dans la misère et l'adversité à tel point que je n'ai pu fréquenter l'école n'ayant pas d'habits décents et encore moins de chaussures. Le peu d'instruction que je possède me provient de mon père et de sa bibliothèque qui était assez importante.
Les plus grands camarades de ma jeunesse furent Voltaire, Rousseau, Diderot et ensuite... Zola.
Mais notre misère était si grande et voulant aider mon père, je m'embauchais à porter des journaux. J'avais douze ans et je gagnais quinze francs par mois.
Puis j'entrais apprenti typographe à l'imprimerie Marguerith-Dupré, devenue l'imprimerie Foncière.
Mon père étant entré manoeuvre aux Établissements militaires, il put s'imposer un gros sacrifice, car comme apprenti je n'étais pas payé quoique faisant douze heures, et quelque fois quatorze heures de travail par jour.
Mon père s'occupait beaucoup. Il m'emmenait dès mon jeune âge aux réunions. C'est ainsi que j'ai connu Sébastien Faure qui venait de jeter sa soutane aux orties. J'ai toujours admiré cet orateur de talent et j'approuvais ses idées anti religieuses.
Mon père ayant été chassé des Établissements militaires, toujours comme anarchiste, il résolut d'organiser sa vie, avec de faibles ressources. C'est alors que, considérant que je devenais une charge pour lui, je partis avant la fin de mon apprentissage sur le tour de France, dont j'ai gardé le souvenir de la liberté ...et du plein air.
Je m'étais syndiqué au Livre dès 1895. J'ai travaillé à Montargis au journal le Petit Gâtinais, devenu je crois un grand quotidien. Mais ce n'était que pour remplacer un camarade en période de vingt-huit jours. Je gagnais six sous de l'heure. D'ailleurs je n'étais pas un typo bien expérimenté, n'ayant rien appris pendant mon apprentissage, car nous étions huit apprentis pour quatre ouvriers qui s'inquiétaient peu de nous inculquer leur science.
Rentré à Bourges après avoir trimardé quelques mois sans trouver de travail, j'avais parcouru tout l'est de la France et une partie de la Suisse.
Puis je travaillais au journal La démocratie du Cher d'où je fus renvoyé avec trois de mes camarades pour raisons d'économies, ce journal se confectionnant désormais avec des article clichés fournis par des agences.
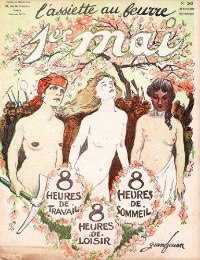
À nous quatre nous fondâmes le journal La Vertu. Un de mes collaborateurs est encore vivant, c'est Albert Bedu, imprimeur à Saint-Amand, qui milita un moment à la Bourse du travail de Bourges.
Notre Vertu fut éphémère et ne parut que sept numéros, faute de se vendre. Un sou privait les gens à cette époque.
Je repris la route et, jusqu'à mon départ au régiment, je travaillais à Dijon et à Gray.
Au retour du régiment je m'embauchais à la Pyrotechnie en qualité de terrassier, au taux de cinquante sept sous par jour et douze heures de travail.
Je quittais cet établissement en mai 1907 et allais travailler à Vichy en qualité de metteur en page du journal. Je gagnais cinq francs par jour. C'était pour moi le Pactole.
La section du Livre de Vichy me confia les fonctions de secrétaire-trésorier que j'ai occupées pendant cinq ans.
Mon activité ne s'arrêtant pas là, je fondais un groupe de Libre Pensée avec deux cents adhérents. Cela me valut d'être renvoyé de l'imprimerie Wallon, le prote (1) étant tout puissant ainsi que la patronne, l'un étant marguillier (2), l'autre dame de paroisse. Mon renvoi se justifiait !
Étant secrétaire adjoint de la Bourse de Vichy, je m'occupais à constituer des syndicats dans la région, surtout chez les terrassiers autour de Cussat. Également j'intervenais dans des réunions politiques au profit de Briand et Régnier, lesquels ne m'en surent jamais gré.
D'ailleurs, je ne fus jamais un ambitieux. Les fonctions que j'ai remplies, syndicales ou autres, furent toujours bénévoles. Je n'ai jamais cherché à en tirer quelque bénéfice, aussi minime soit-il. L'honneur et le devoir accompli m'ont suffit.
En 1907 je gagnais Villeneuve Saint Georges sur les instances de la Fédération du livre, j'y constituais un syndicat qui existe encore à Corbeil.
Dans cette localité, ayant entrepris une campagne pour obtenir l'apposition du label fédéral sur les imprimés, j'eus l'avantage lors de ma démarche, d'être mis à la porte, presque manu militari, de l'imprimerie Crété, laquelle, aujourd'hui est le foyer actif du syndicat. Je suis heureux d'avoir été le premier à donner l'éveil à mes confrères du livre de là bas.
Villeneuve Saint Georges ! Quel drame ai-je vécu là !
Je travaillais à l'imprimerie ouvrière qui venait d'être créée. Les débuts étaient difficiles, non par le manque de travail, mais le manque de ressources. J'ai connu des semaines sans salaire, ou insuffisant. Encore que je fusse seul, je n'y pu tenir, et, par la suite je regagnai Paris où je travaillais à l'Imprimerie Nationale, ce qui me remit à flot.
Le 30 juillet 1903 fut une journée terrible. Tous les militants du mouvement ouvrier ont souvenance du drame occasionné par la grève des terrassiers de Draveil-Vigneux auxquels les patrons refusaient une augmentation de salaire d'un sou en plus par heure (3).
Un journal local, La Marseillaise, a bien voulu reproduire l'article où dans un journal parisien, je citais les péripéties de cette affreuse journée. Je n'y reviendrai pas. Mais je veux donner quelques détails supplémentaires.

Mon camarade Marchand tomba à mes côtés au moment où nous nous séparions, après que nous ayons constaté que notre présence devenait inutile. Je vois encore sa cervelle rouler sur le pavé. Ensemble, quelques instants au paravant nous avions transporté un militant de Puteaux, Lebon, dans une pharmacie où il devait mourir. Des morts et des blessés étaient déjà étendus là. C'est un spectacle qu'un militant n'oublie pas. Je dus mon propre salut qu'en me laissant tomber et en rampant pour me mettre à l'abri du champ de massacre. Il y eut une douzaine de morts, plus deux cents blessés. Ah ! Les ordres de Clémenceau, ministre du moment furent bien exécutés par le général Virvaire, blessé lui aussi, mais ...au talon de la botte.
Secrétaire du syndicat dont faisait partie Marchand, et celui ci étant sans famille à Villeneuve, mais y ayant un domicile, je crus de mon devoir d'aller réclamer son cadavre. Je ne concevais pas qu'on l'eut transporté à la morgue du pays et non pas à son logis.
M'étant adressé au commissaire de police qui me renvoya au maire avec des paroles peu amènes, celui ci me renvoya à M. Hennion, directeur de la Sureté. Après son refus catégorique de me faire remettre le corpset, sur ma protestation, la promesse de me faire rejoindre mes amis les bandits - telle fut son expression - Griffuelhes, Yvetot ...etc, à la prison de Corbeil. J'obtins après force engueulade, mise à la porte du bureau où il se tenait, rappel ...etc, que le corps me serait remis mais en présence d'un membre de la famille qu'il me fallait rechercher dans Paris, sous la surveillance des sbires de l'aimable monsieur.
Mes recherches furent d'ailleurs infructueuses, malgré les quelques indications que j'avais obtenues de Marchand de son vivant, et, rentré exténué à Villeneuve je me trouvais en présence Renaudel et Sembat qu'un membre de la famille avait rejoints.Ils avaient promesse de remise du cadavre, mais celui ci fut transporté à la sauvette au domicile. Nous nous trouvâmes devant le fait accompli.
J'avais vu Sembat dans la journée. Je tiens à dire que, courageusement, il alla tirer par son habit le préfet Autrand pour qu'il vienne se placer entre les belligérants et ainsi essayer d'user de son autorité pour empêcher la tuerie. Très prudemment il secachait dans une des salles d'attente de la gare.
J'ai travaillé à Paris jusqu'à la guerre de 1914-18. Mobilisé j'ai subi mon sort sans gloire. Pris dans un bombardement, j'y ai gagné une maladie de coeur que je supporte philosophiquement.
À la démobilisation, je revins à Bourges où j'avais laissé mon épouse. Nous ne regagnâmes pas Paris.
En 1920, mes confrères de la 28e section du livre me confièrent la fonction de secrétaire. C'était un syndicat à reconstituer. Il y avait douze adhérents et cinquante deux sous en caisse que mon ami Gessat trésorier, conservait religieusement. Nous arivions assez vite à cent vingt adhérents. Je constituais une section à Vierzon. Nous eûmes à batailler durement pour obtenir des augmentations de salaires, dix sous par jour que messieurs nos employeurs daignaient nous accorder avec des larmes dans les yeux puisque nous les ruinions. En 1922 nous déclarions une grève avec satisfaction obtenue.
J'ai travaillé plusieurs années à l'imprimerie ouvrière, puis je montais une imprimerie en 1928 pour le compte d'un monsieur qui, au bout de quelques mois renvoya son personnel syndiqué. Quoique non touché par cette mesure, je crus de mon devoir de suivre mes camarades dans leur exil.
Dans l'impossibilité de travailler à Bourges parce qu'en ces temps un secrétaire de syndicat était un suspect et ne s'embauchait pas, je dus aller à Cosne. Je profitais de mon séjour dans cette localité pour constituer une section du livre, ce qui amena une amélioration de salaires aux camarades typos jusque là inorganisés.
En 1924, au congrès du livre à Lille, j'ouvris une large discussion sur les congés payés, peu goûtés à l'époque par messieurs du patronat. Les militants que cette discussion intéresserait en trouveront les débats in extenso sur la brochure dudit congrès.
Appelé par monsieur Boin pour monter son imprimerie, je repris ma fonction de secrétaire au début de 1930.
J'oubliais de dire que je fus près de dix ans secrétaire adjoint de l'Union des syndicats ouvriers aux côtés de mon vieil ami Hervier et secrétaire de La Prolétarienne, animée par Gosnat aujourd'hui maire adjoint d'Ivry. J'étais en même temps secrétaire du comité d'action, lequel réunissant toutes les organisations de gauche fut le Front populaire à Bourges, avant la lettre.
Depuis longtemps je suis secrétaire fédéral de la Libre Pensée dans le Cher.
En 1930, je dus constituer avec l'aide de quelques camarades, la Caisse ouvrière d'assurances sociales Le Travail dont on s'était peu préoccupé malgré les instances et instructions de la CGT. Ce fut un gros travail, d'autant plus que les positions étaient déjà prises par d'autres caisses plus diligentes.
Enfin, au premier juillet 1930, nous pûmes fonctionner avec un Conseil d'administration exclusivement ouvrier, comme le permettait l'article 28 de la loi. Nous avions deux cent trente deux adhérents.
Je fus désigné président, je le suis encore. C'est le plus grand honneur de ma vie de militant. Mais en 1932, je tombais malade au retour d'un congrès de l'Union des syndicats tenu à Vierzon.
Ma santé améliorée en partie, je repris toute mon activité, encore que durant ma maladie je ne cessais pas de m'intéresser à la marche de la Caisse, dont je continuais à signer les pièces.
Malgré tout, parce qu'on avait pensé trop tard à sa constitution; parce qu'on s'était butté à l'indifférence coupable des assurés sociaux, notre caisse végéta jusqu'en 1938 avec cinq cents adhérents.

On me conseilla de faire fusionner la Caisse avec la Caisse départementale. Je refusais catégoriquement. La CGT avait dit de vivre; coûte que coûte, on vivrait. C'est alors qu'avec l'aide de la Fédération des mutuelles ouvrières, nous organisâmes des réunions de propagande à Saint Amand, Vierzon, où existaient déjà de bons éléments.Puis, seul, j'entrepris des réunions à Mehun, Foëcy, Argent ...etc. Nos effectifs s'enflèrent et, malgré toutes les embûches créées quelquefois par les services compétents; malgré l'indifférence tenace des intéressés, la Caisse Le Travail a pu vivre et va entrer au premier juillet prochain avec ses quatre mille adhérents, dans le cadre du nouveau régime de Sécurité sociale.
Elle va avoir cet honneur - et j'ai l'ambition d'en prendre ma part - de ne pas se voir disparaître, mais au contraire s'étendre, puisque c'était les ouvriers seuls qui l'administraient, et ce sera encore eux qui administreront la caisse de Sécurité sociale prévue par l'ordonnance du 19 novembre 1945 (4).
Qu'il me soit permis ici de saluer la mémoire de mes deux bons camarades Boulanger et Lemaire, contrôleur des Caisses Le Travail et directeur de la Fédération des Mutuelles Ouvrières. Tous deux sont morts torturés, l'un à Nantes, l'autre à Buchenwald, car non seulement ils s'occupaient des caisses mais aussi de la réorganisation des Unions départementales de syndicats ouvriers, selon les directives de la CGT clandestine. Je n'ai eu qu'à me louer des bons conseils qu'ils me donnaient.
Actuellement, j'emploie le reste de mon activité au service des vieux. J'ai constitué à Bourges une amicale sous l'égide de la CGT. Elle groupe mille trois cents adhérents. J'en suis le président.
Je suis également secrétaire des amicales des vieux du Cher. Je parcours le villes et les communes du département, aidé par de bons camarades, et nous avons créé des sections avec des effectifs importants à Vierzon, Saint Amand, Dun Foëcy, Mehun, Nérondes, Sancoins, Bannay. Je suis appelé à Henrichemont, Verdigny ...etc.
Et je continuerai, heureux la tâche accomplie, heureux si ma vie a pu servir au mieux être de la classe ouvrière.
Mais je ne saurais terminer ces succintes mémoires sans y associer mon épouse. Par son activité, par sa sympathie aux oeuvres sociales, elle m'aide toujours dans ma tâche. Qu'elle en soit ici remerciée et félicitée.
Louis Fredonnet 1947.
- Prote. Chef d'atelier dans une imprimerie.
- Marguillier : membre du Conseil de la paroisse.
- Pour obtenir une augmentation de salaires d'un sou de l'heure la grève des carriers de Draveil commença le 2 mai 1908. Clémenceau décida de la faire réprimer. Plusieurs grévistes furent tués pendant les manifestations qui se déroulèrent jusqu'au 30 juillet 1908. http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_de_Draveil-Villeneuve-Saint-Georges
- Avant la seconde guerre mondiale, la France disposait dans les textes (à partir de 1930), d’un système d’assurances sociales ; mais il comportait de nombreuses lacunes, et, n’étant pas obligatoire, il était très loin de bénéficier à tous les salariés. La Sécurité sociale de 1945 est l’une des conquêtes majeures du monde du travail, elle assure à chaque salarié une protection de la naissance à la fin de la vie. Le témoignage de Louis Fredonnet éclaire singulièrement notre actualité.
> Si une lectrice ou un lecteur de cette page possède des informations, photos, documents sur Louis Fredonnet, Pierre Hervier et leur époque, qu'il m'envoie un message. Merci.
> Lire dans gilblog : Pierre Hervier, berrichon et émancipateur. >>> Lien.
Historique du système français de sécurité sociale. >>> Lien.